|
Vous avez raison.
La nouvelle courbe (en rouge) part du même point que le Bip40 en 1983 mais à partir de 1993 diminue plus fortement : le % de jeunes sans qualification fait diminuer les inégalités scolaires. |
|
|
|
Vous avez tort,
La nouvelle courbe (en rouge) part du même point que le Bip40 en 1983 mais à partir de 1993 diminue plus fortement : le % de jeunes sans qualification fait diminuer les inégalités scolaires.
|
|
|
|
Vous avez raison,
la courbe orange qui représente le % de jeunes sans qualification diminue plus que celle de l'ensemble des inégalités d'éducation (en bleu).
En effet, 15 % de jeunes sortaient sans finir leur scolarité en 1983, 7 % en 2002 (ces chiffres ne sont pas dans le graphique mais ont servi à construire les notes).
Mais la réduction est très faible depuis 1995.
|
|
|
|
Vous avez tort,
la courbe orange qui représente le % de jeunes sans qualification diminue plus que celle de l'ensemble des inégalités d'éducation (en bleu).
En effet, 15 % de jeunes sortaient sans finir leur scolarité en 1983, 7 % en 2002 (ces chiffres ne sont pas dans le graphique mais ont servi à construire les notes).
Mais la réduction est très faible depuis 1995. . |
|
|
|
Vous avez raison,
ce ratio étudie la différence entre le recrutement par CSP en classe préparatoire.
Les inégalités sociales y sont particulièrement fortes. |
|
|
|
Vous avez tort,
le ratio compare les catégories socio-porfessionnelles.
Le recrutement en classe préparatoire est très élitiste et les inégalités sociales y sont particulièrement fortes.
|
|
|
|
Vous avez
tort,
le graphique montre l'évolution au "complément au taux de bacheliers parmi les jeunes" : par exemple, en 2002, 62,9 % des jeunes en âge d'avoir le bac l'avaient obtenu, le complément est 100 % - 62,9 % = 37,1 % ne l'avaient pas obtenu.
C'est le complément au taux de bacheliers qui est donné pour qu'une augmentation de ce taux indique une augmentation des inégalités.
|
| |
|
|
Vous avez raison ,
le graphique montre l'évolution au "complément au taux de bacheliers parmi les jeunes" : par exemple, en 2002, 62,9 % des jeunes en âge d'avoir le bac l'avaient obtenu, le complément est 100 % - 62,9 % = 37,1 % ne l'avaient pas obtenu.
C'est le complément au taux de bacheliers qui est donné pour qu'une augmentation de ce taux indique une augmentation des inégalités. |
|
|
|
Votre conclusion est trop générale ,
certaines inégalités ont diminué, d'autres augmenté et deux périodes sont à distinguer.
|
|
|
|
Votre conclusion est trop générale,
certaines inégalités ont diminué mais d'autres augmentent depuis 1990. |
|
|
|
|
Vous avez raison,
l'indicateur est une moyenne des évolutions : en moyenne, les inégalités scolaires ont diminué en France depuis 1983, mais avec deux périodes distinctes : une forte baisse jusqu'en 1994, une légère hausse depuis.
|
|
|
|
|
Réponse incomplète : deux périodes sont à distinguer.
|
|
|
|
|
Réfléchissez ! une conclusion est possible !
|
|
|
|
|
Les ratios des deux premières colonnes sont le rapport entre la note obtenue par les 10 % d’élèves les plus forts et celle des 10 % les plus faibles en classe de 6 e dans chacune des deux matières.
Par exemple, en 2003, les 10 % d’élèves les plus faibles en français en 6 e ont obtenu la note moyenne de 34,3 sur 100 et les 10 % d’élèves les plus forts la note moyenne de 88,5. Le ratio est de 88,5 / 34,3 = 2,58.
En écart élevé indique donc de grandes inégalités de niveau scolaire entre les élèves.
Ces chiffres viennent du ministère de l’éducation nationale qui mène chaque année une évaluation en début de 6e sur un échantillon représentatif des élèves depuis 1990. Les compétences évaluées concernent celles exigibles à l’entrée en 6 e donc normalement acquises à l’école primaire ou en cours d’acquisition.
En français, on cherche à tester : la compréhension d’un texte, son analyse, la maîtrise des outils de la langue, la production d’un texte. En mathématiques, les travaux géométriques mettent l’accent sur les exercices de perception et de construction des figures. La numération, le calcul, des problèmes numériques et le traitement des informations sont également évalués.
|
|
|
|
Le taux de sortants sans qualification est le % de jeunes qui sortent non qualifiés de l'école.
Mais qu’est-ce qu’être sans qualification ? La définition date des années 1960, ce qui permet des comparaisons, mais est restrictif : ce sont des jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir totalement suivi les enseignements d’un second cycle du secondaire (général ou technologique). Ils étaient 60 000 en 2001. On exclut les jeunes qui échouent aux examens : ils étaient également 60 000 en 2001.
La baisse du rapport indique donc que le nombre de jeunes qui ont quitté l’école en cours de scolarité secondaire diminue par rapport au nombre total de jeunes sortants du système scolaire.
|
|
|
"Complément au taux de bacheliers"
Qu’est-ce que c’est ? Le % de jeunes d’une classe d’âge qui n’obtient pas le baccalauréat. Par exemple, 38,10 % en 2002 indique que sur 100 jeunes 37,1 n’ont pas eu le bac, et donc que 62,9 l’ont eu.
Qu’est-ce que ça fait là ? En France, le baccalauréat est le symbole de l’ouverture vers les études longues. La diminution du nombre de jeunes qui ne l’obtiennent pas, et donc l’augmentation de ceux qui l’ont, indique a priori une hausse du niveau scolaire.
Mais attention aux chiffres !
Le baccalauréat s’est diversifié, à côté des séries générales qui conduisaient à l’université et aux grandes écoles, les baccalauréats techniques puis professionnels se sont développés. Dans le même temps, les études supérieures courtes (bac + 2) ont progressé.
Les difficultés de l’emploi conduisent à une concurrence accrue des jeunes et à une certaine dévalorisation des diplômes supérieurs : l ’augmentation du niveau d’études ne correspond pas totalement à une hausse des qualifications reconnues, par exemple, en 1997, plus de 20 % des jeunes ouvriers non qualifiés avaient le niveau du bac.
|
|
|
Ratios enfants de cadres/ouvriers en CPGE et cadres/ouvriers :
Le premier ratio est le rapport entre le nombre d’enfants de cadres en classe préparatoire aux grandes écoles et le nombre d’enfants d’ouvriers dans ces mêmes classes corrigé par la structure par catégorie sociale de la population.
Le deuxième compare les enfants de cadres à ceux d’employés.
Qu’est-ce que ça fait là ? Sur 500 000 bacheliers 40 000 vont en 2002 vers les classes préparatoires aux grandes écoles françaises : un recrutement très élitiste qui est sensible aux inégalités sociales et culturelles. La part des enfants d’ouvriers et d’employés représente l’ouverture démocratique de ces enseignements. Sa hausse indique plus d’inégalités conduisant à une moindre mobilité sociale.
|
|
|
|
L'indicateur partiel pour l'éducation du BIP40 inclut 6 séries statistiques notées (chacune de 0 à 10). Pour les combiner, des coefficients sont affectés à chaque série et une moyenne pondérée est faite. L'indicateur est donc une note de 0 à 10, c'est son évolution qui compte. Une modification des coefficients modifie l'évolution.
Un exemple : |
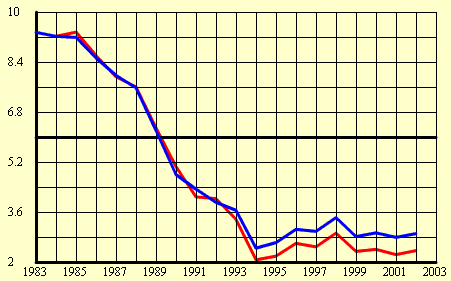
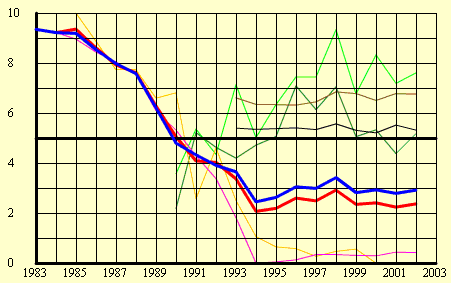
![]() Regardez la courbe "% de sans qualification" (courbe orange du graphique de droite).
Regardez la courbe "% de sans qualification" (courbe orange du graphique de droite).![]() On peut conclure que
On peut conclure que