L'indice
de Gini mesure les inégalités, c'est le rapport
: aire entre la courbe de Lorenz et la bissectrice / aire
sous la bissectrice. Plus il est proche de 0, plus la répartition
est égalitaire : donc entre 1970 et 1990, l'égalité
entre les salariés s'est accrue. Au contraire, depuis
1990, les inégalités s'accroissent.
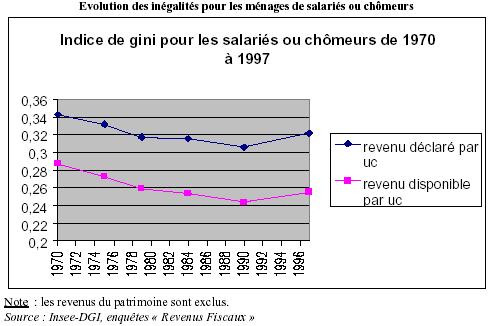
|
| |
|
|
Patrimoine
brut : total des actifs financiers, immobiliers ou professionnels
possédés par le ménage, l’endettement
n’étant pas déduit. Le patrimoine brut
peut être ventilé en trois composantes :
- le patrimoine domestique (logements occupés
par le ménage)
- le patrimoine de rapport (placements financiers ou immobiliers
procurant revenus et plus-values)
- le patrimoine professionnel (actifs utilisés
par les travailleurs indépendants dans le cadre de
leur activité). |
| |
|
|
|
Une plus-value est
un gain réalisé sur une vente : lorsque l'on
revend plus cher que le prix d'achat un logement ou une
action.
|
| |
 |
|
|
Les 10 % des ménages
les plus riches en patrimoine en possèdent plus de
40 %.
|
| |
 |
|
|
Le patrimoine est plus
concentré : sa courbe (bleue) est plus éloignée
de la bissectrice.
Le patrimoine n'a pas la même composition selon son
niveau : pour le patrimoine médian, il est composé
du logement d'habitation du ménage.
Le patrimoine des 10 % les plus riches est composé
en grand partie de valeurs mobilières dont les revenus
ont fortement progressé en 30 ans (malgré
une baisse dans les années 1990)
|
| |
|
|
|
Le quartile divise
la population en 4 parts : il correspond donc à 25
% de la population.
Les 25 % de ménages les plus riches en revenu, épargnent
20 % de leur revenu.
|
| |
|
|
| Le
taux d'épargne est la part du revenu qui est épargnée
(non consommée). |
| |
|
|
Le
patrimoine procure des revenus : loyers, dividendes, intérêts...
Ces revenus du patrimoine ont progressé plus fortement
que les salaires depuis 1985 (malgré une baisse de
1993 à 1997). Ils ont permis à leur détenteur
d'augmenter encore leur patrimoine.
Le quart des ménages ayant le niveau de vie le plus
élevé touche 8 fois plus de revenus du patrimoine
que le quart des ménages ayant le niveau de vie le
plus faible, alors qu’il ne gagne que 5 fois plus sous
forme de revenus d’activité ou de remplacement.
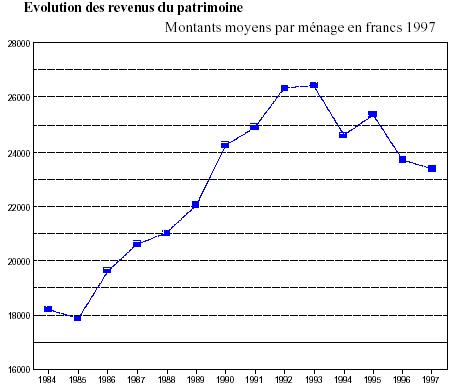 |
| |
|
|
| L'élasticité
compare deux variations : ici la variation de l'épargne
par rapport à la variation du revenu. Lorsque le revenu
augmente de 1% par exemple, l'épargne augmente de 1,4
%. |
|
|
|
|
Un
"bien de luxe" fait référence à
la loi d'Engel : lorsque les revenus sont faibles, les ménages
satisfont prioritairement leur besoins de nécessité,
ce type de dépense occupe la plus grande part de leur
budget.
Lorsque les revenus sont élevés, les besoins
de nécessité sont satisfaits, mais aussi ceux
"de luxe", non nécessaires, c'est le cas
de l'épargne (qui n'est pas un bien au sens propre)
qui permettra d'avoir une sécurité et d'obtenir
des revenus futurs. |
| |
|
|
Conclusion
n°3 : les inégalités de patrimoine sont
plus importantes que celle de revenu car le taux d'épargne
progresse plus vite que les revenus.
Depuis le début des années 1980, les revenus
du patrimoine progressent plus vite que les salaires, ce qui
augmente les inégalités. |
| |
|
|
| L'épargne
augmentant plus vite que les revenus, le patrimoine constitué
augmente lui aussi plus vite que les revenus. |
| |
|
|
|
1-
La concentration du patrimoine
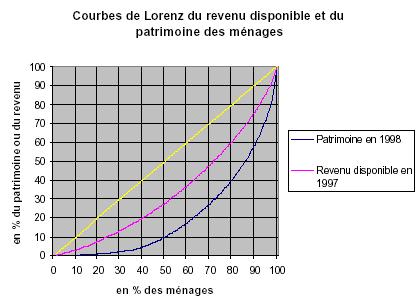 ................ ................ |
|
|
|
 Quelle part du patrimoine total possèdent
les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ?
Quelle part du patrimoine total possèdent
les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ?
 Le patrimoine est-il plus
ou moins concentré que le revenu ?
Le patrimoine est-il plus
ou moins concentré que le revenu ?
2- Pourquoi ?
| Le
taux d’épargne d’un ménage progresse
en fonction de son revenu : nul voire négatif dans le
premier quartile, il avoisine
20 % dans le quartile de revenu le plus élevé.
L’élasticité
du montant de l’épargne par rapport au revenu est
estimée à environ 1,4 dans les enquêtes
Budget de famille. Une élasticité supérieure
à l’unité signifie que la part du revenu
qui n’est pas consommée est d’autant plus grande
que le revenu est lui-même élevé : l’épargne
est un bien de luxe, elle
est donc plus concentrée que le revenu. |
| Depuis
le début des années 80, tandis que le revenu des
ménages progresse modérément (environ +1
% par an en termes de niveau de vie), le patrimoine des ménages
progresse rapidement (environ +3 % par an) et plus encore le
patrimoine de rapport (+5 % par an entre 1984 et 1997). Il en
résulte une tendance à l’accroissement des
revenus du patrimoine, qui a toutefois été contrariée
par la baisse des taux de rendement dans les années 80
et plus encore dans les années 90. Les revenus du patrimoine
ont fortement progressé jusqu’en 1993 avant de diminuer
légèrement depuis. |
|
|
|
 En quoi l'épargne
explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?
En quoi l'épargne
explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?
 Pourquoi la concentration
des patrimoines augmente-t-elle ?
Pourquoi la concentration
des patrimoines augmente-t-elle ?
|
![]() Quelle part du patrimoine total possèdent
les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ?
Quelle part du patrimoine total possèdent
les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ? ![]() Le patrimoine est-il plus
ou moins concentré que le revenu ?
Le patrimoine est-il plus
ou moins concentré que le revenu ? ![]() En quoi l'épargne
explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?
En quoi l'épargne
explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?![]() Pourquoi la concentration
des patrimoines augmente-t-elle ?
Pourquoi la concentration
des patrimoines augmente-t-elle ?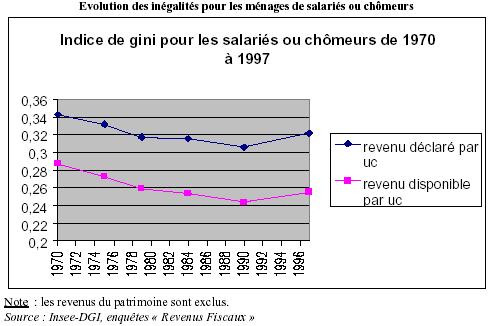
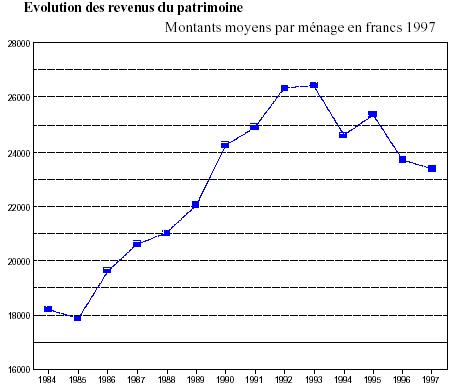
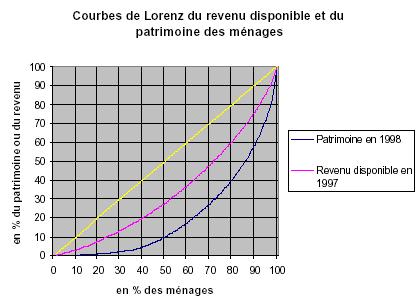 ................
................